La Guadeloupe dans le collimateur de l'Agence française anticorruption

Oui, cette information est confirmée par l'AFA elle même. L'agence française anticorrupton a même délégué la magistrate Mariannig Imbert en Guadeloupe pour un plan d'action inédit dans les Antilles-Guyane. Elle y forme actuellement les magistrats et enquêteurs locaux, ainsi que ceux de Martinique et Guyane, à mieux identifier et instruire les affaires d'atteintes à la probité, comme la corruption, le détournement de fonds publics, le favoritisme, la prise illégale d'intérêts, la concussion ou le trafic d'influence.
Le déplacement Mariannig Imbert s'inscrit dans un contexte alarmant : selon le dernier rapport de l'AFA, la Guadeloupe figure parmi les territoires les plus touchés par ces infractions en France. Entre 2016 et 2024, le département enregistre plus de 4,1 infractions pour 100 000 habitants et 217,3 condamnations par million d’habitants, des taux bien supérieurs à la moyenne nationale. Les Outre-mer insulaires, comme la Guadeloupe, la Corse, la Polynésie ou la Martinique, sont particulièrement concernés, potentiellement en raison de leur insularité et de leur éloignement du pouvoir central. L'objectif est double : renforcer la répression judiciaire et promouvoir la prévention. Une session de formation dédiée aux élus locaux est d'ailleurs prévue après les municipales de printemps 2026, pour équiper les communes et collectivités d'outils contre les dérives et en faveur de la transparence.
Nous nous sommes procuré le rapport de l'AFA.
Les Outre-mer insulaires (DROM-COM) sont identifiés comme des zones à risque élevé, en raison de leur insularité, de l'éloignement du pouvoir central et des interdépendances public-privé. Le rapport ne fournit pas de données granulaires par territoire (ex. : Guadeloupe seule), mais agrège les indicateurs pour l'ensemble des Outre-mer, confirmant une surreprésentation par rapport à la moyenne nationale.

Est-ce à dire que loin de "papa" les enfants font des "bêtises" ? Un peu léger comme argument . Les chiffres parlent d'eux mêmes.
Taux de condamnations
217,3 à 250,5 pour million d'habitants (moyenne 2014-2023), soit 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale et comparable à la Corse (424,4, le plus élevé). Cela reflète une intensité accrue des infractions, avec une hétérogénéité territoriale forte (Outre-mer parmi les "points chauds" avec la Corse et PACA).
Signalements
3 % des signalements compétents de l'AFA (environ 6 sur 202) concernent les Outre-mer, contre 26 % pour l'Île-de-France. Parmi les collectivités territoriales d'Outre-mer, 7 cas ont été signalés (5 % des signalements publics territoriaux), incluant 2 départements et 1 société publique locale ultra-marine.
Contrôles et infractions
2 conseils départementaux d'Outre-mer contrôlés en 2024 (sur 8 au total). Les risques élevés portent sur les aides sociales, les marchés publics et la gestion RH. Plus de 40 % des recommandations AFA ont été mises en œuvre, mais des lacunes persistent dans les audits internes. Les Outre-mer contribuent à la hausse nationale des procédures (+8,2 % en 2024), sans découpage précis, mais avec une exposition amplifiée dans les compétences sociales et les interconnexions sectorielles.
Un séminaire en juillet 2024 avec le Suriname a abordé les risques transfrontaliers pour la Guyane (prévention, détection, répression). L'Observatoire des atteintes à la probité (analyse de 504 décisions 2021-2022) confirme une prédominance de la corruption dans les Outre-mer, avec des profils d'infractions liés au bloc communal et à la construction.
Rapport d'activité 2024 de l'Agence Française Anticorruption (AFA)
Le rapport d'activité 2024 de l'AFA, publié en juillet 2025, dresse un bilan exhaustif des atteintes à la probité (corruption, trafic d'influence, favoritisme, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, concussion, etc.) en France. Il s'appuie sur des indicateurs variés : enquêtes de perception, procédures policières et judiciaires, contrôles de l'AFA, et signalements. Le document met en lumière une hausse globale des cas détectés, tout en soulignant l'ampleur sous-estimée du phénomène en raison de sa nature occulte. Voici les principaux détails, avec un focus sur les tendances nationales et les territoires d'Outre-mer (comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane).
Tendances nationales globales
Signalements reçus par l'AFA : 802 en 2024, soit une augmentation de 84 % par rapport à 435 en 2023 (et +164 % depuis 2022). Après déduplication (219 doublons), 583 signalements uniques ont été traités en moyenne 24 jours. Parmi les 202 signalements relevant de la compétence de l'AFA (35 %), les infractions les plus citées sont la prise illégale d'intérêts (23 %), la corruption (15 %) et le détournement de fonds publics (14 %). L'AFA a transmis 58 cas à des autorités externes (dont 17 aux procureurs pour poursuites pénales) et 36 en interne pour des contrôles.
Procédures policières et de gendarmerie (données SSMSI, procédures closes)
934 atteintes à la probité en 2024 (+8,2 % vs. 2023, +50,9 % depuis 2016). Répartition : corruption (324 cas, +16,5 %), concussion (199 cas, +29 %), détournement de fonds publics (168 cas). Le taux national moyen est inférieur à 1,5 infraction pour 100 000 habitants dans la plupart des départements, mais dépasse 4,1 dans les zones à haut risque (ex. : Var avec 83 cas).
Procédures judiciaires
En 2023 (dernières données complètes), 2 432 mises en cause (+34 % sur 10 ans), avec une poursuite effective dans 51 % des cas. Condamnations cumulées 2014-2023 : 3 583 (424 en 2023), avec des peines incluant 292 emprisonnements (28,8 % ferme) et 291 amendes (93,5 % ferme). Taux de condamnations par million d'habitants (moyenne 2014-2023) : 107-115 en Île-de-France, 87,8-124,7 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Perceptions
70 % des Français estiment la corruption "répandue" (Eurobaromètre 2024, +1 pt vs. 2023). Dans les entreprises, 30 % ont été confrontées à de la corruption ou du trafic d'influence ces 5 dernières années ; 45 % la voient comme un frein à leur activité.
Contrôles AFA : 17 auprès d'acteurs publics (101 cumulés depuis 2018) et 10 auprès d'entreprises (165 depuis 2017). Focus sur les collectivités territoriales (54 contrôles depuis 2018), avec des faiblesses persistantes en cartographie des risques et contrôles comptables.
Le rapport note un manque de données exhaustives judiciaires, mais appelle à une meilleure détection pour contrer la hausse structurelle (+50,9 % des procédures depuis 2016).
Qui pourrait croire que ce sont les PME-PMI en Guadeloupe qui sont visées ? Les collectivités, grands groupes et autres Sem font effectivement l'objet d'une attention accrue en matière de probité, exposés aux risques de corruption selon les rapports de l'Agence Française Anticorruption (AFA). Identifiés comme des "points chauds".
Omerta ou sourdine médiatique ?
Face à ces révélations explosives, on pourrait s'attendre à une indignation tonitruante de la part des médias ultramarins. Or, c'est tout le contraire. En Guadeloupe, par exemple, un blogueur pointait déjà en 2015 cette "omerta guadeloupéenne".
Car oui, la presse d'Outre-mer est fragile. En juin 2025, l'Alliance de la presse d'information générale créait une commission dédiée aux titres ultramarins, confrontés à une "situation économique critique". Publicités locales, subventions et proximité avec les acteurs publics pèsent lourd. Résultat : autocensure.
Un rapport parlementaire sur les atteintes à la probité note que les Outre-mer cumulent 29 % des infractions de corruption en France, mais la couverture médiatique reste "ténue", limitée à des faits divers sans profondeur. Presse achetée ? Les preuves directes manquent, mais les soupçons pullulent.
C'est là que l'hypocrisie saute aux yeux. Ces mêmes plumes ultramarines, si vives pour dénoncer le "mépris de l'Hexagone" – réformes fiscales imposées, sous-investissements dans les infrastructures, ou encore le "colonialisme économique" de Paris – se font discrètes dès qu'il s'agit de pointer du doigt les élites locales.
Un sénateur martiniquais l'admettait récemment : "La presse régionale n'en fait pas assez sur la corruption locale, par peur de représailles ou par manque de moyens". Comme le soulignait un rapport sur les discriminations en Outre-mer, cette opacité médiatique renforce le sentiment d'abandon.
la presse locale doit sortir de l'omerta. Subventions renforcées, formations à l'investigation, et une déontologie intransigeante pourraient y aider. Mais tant que les journalistes préfèrent aboyer contre Paris plutôt que mordre au talon des puissants locaux, la démocratie ultramarine restera boiteuse. Il est temps que ces voix, si prompte à crier "justice" pour les grandes causes hexagonales, se tournent vers les vraies indignités : celles qui, chez nous, volent aux plus modestes leur droit à un toit digne.

Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : du déni à tous les étages, sans vergogne, sans sourciller

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

La solitude en fin d’année 2025 : une ombre persistante derrière les lumières des fêtes
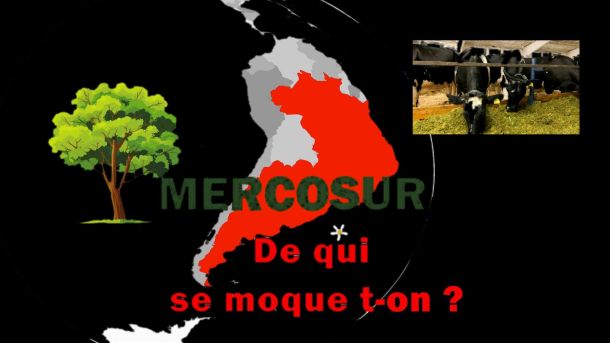
Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »
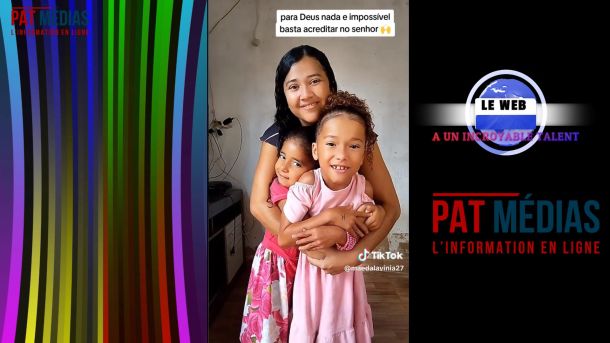
Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour
Catégories d'articles


