
Dans les rues de Tel-Aviv, les pleurs des familles d'otages ont résonné comme un chœur funèbre pendant deux ans.
Aujourd'hui, le 18 octobre 2025, alors que le cessez-le-feu imposé par l'accord Hamas-Israël libère les 20 derniers captifs vivants et entame le rapatriement des corps, une question brûlante surgit : et si ces torrents de larmes avaient paralysé le cerveau stratégique d'Israël ? Emportée par l'émotion collective, la nation a cédé à un marchandage odieux, sacrifiant sa sécurité à long terme sur l'autel de la compassion immédiate. Polémique ? Absolument. Nécessaire ? Plus que jamais, pour éviter que l'hystérie compassionnelle ne devienne la tombe de la souveraineté juive.
Le chantage émotionnel : une arme plus létale que les roquettes
Rappelez-vous : le 7 octobre 2023, le Hamas enlève 251 otages, semant l'horreur dans les kibboutzim et les festivals de musique. Deux ans plus tard, sous la pression américaine et qatarie, Benjamin Netanyahou signe un accord qui libère ces 20 survivants contre 1 968 prisonniers palestiniens – dont des assassins de masse comme ceux impliqués dans les attentats de la seconde Intifada – et 135 corps de "détenus" gazaouis.
Le Hamas, ce bras armé de l'Iran, jubile : il récupère ses combattants aguerris, prêts à retenter l'assaut. Et qui a forcé la main du Premier ministre ? Pas tant les roquettes du Jihad islamique que les manifestations des familles, ces veillées aux chandelles où les larmes coulent en direct sur les réseaux sociaux.Ces pleurs, amplifiés par une presse complaisante et des ONG comme B'Tselem qui humanisent les bourreaux, ont transformé une tragédie en otage politique. Netanyahou, accusé de corruption et d'inaction, ploie sous le poids émotionnel : "Les familles exigent tout, maintenant", martèlent les titres du Jerusalem Post.
Résultat ? Israël restitue des dépouilles de Palestiniens tués en combat – 135 à ce jour– et promet de ne pas bombarder les tunnels où gisent encore 18 corps d'otages israéliens, certains piégés d'explosifs selon le Hamas lui-même.
Quand les larmes coulent, la raison s'évapore : on négocie avec des terroristes comme si c'était un divorce à l'amiable, oubliant que chaque prisonnier libéré est une roquette en sursis.
Les familles, ces tyrans bien intentionnés
Pity the families, diront les bien-pensants. Elles ont vu leurs enfants violés, torturés, affamés dans les geôles de Gaza.
Eliyahu Margalit, 75 ans, dont le corps a été rendu hier, symbolise l'horreur. Mais précisément : en exigeant un cessez-le-feu total et immédiat, ces familles – soutenues par des figures comme Noa Argamani, rescapée iconique – ont imposé un diktat irrationnel. Sur X, les posts fusent : "Les jumeaux Berman s'embrassent après deux ans", "Omri Miran retrouve les siens". Poignant ? Oui. Stratégiquement suicidaire ? Hélas.Car le Hamas n'a rendu que quatre corps initiaux ; les autres sont "sous les décombres" ou "à sept étages sous terre".
Et Israël, paralysé par la peur d'un "nouveau 7 octobre émotionnel", accepte ce chantage post-mortem. Où est la fermeté de Tsahal, forgée dans les guerres de Kippour ? Éteinte par les sanglots télévisés. Les colons de Cisjordanie, eux, protestent contre la libération de violeurs présumés, mais leurs voix sont noyées dans le flot lacrymal. Résultat : 10 000 Palestiniens restent en détention, mais le Hamas, regonflé, prépare déjà la prochaine vague. Trump, qui parade en "président de la paix" avec ses casquettes distribuées aux ministres israéliens, applaudit ce deal bancal – un coup de maître pour Doha, un suicide assisté pour Jérusalem.
Une leçon pour l'Occident : l'émotion, opium du peuple juif
Au-delà d'Israël, cette saga révèle un mal occidental : la tyrannie de l'émotion. En France, où les manifestations pro-palestiniennes hurlent "Free Palestine" sans un mot pour les otages, on accuse Netanyahou de "génocide" tout en pleurant les captifs. Hypocrisie ? Non, logique perverse : les larmes israéliennes légitiment les concessions, pendant que les cris palestiniens justifient l'agression. Le Hamas, fin stratège, exploite cela : il promet de rendre "tous les corps", mais retarde, piégeant Israël dans un cycle de négociations interminables. Et si, au lieu de céder aux larmes, Israël avait maintenu la pression militaire ? Gaza, rasée mais pas pacifiée, aurait peut-être forcé un vrai désarmement. Au lieu de cela, les familles, ces "tyrans bien intentionnés", ont gagné la bataille des cœurs – et perdu la guerre de la survie.
Quand on a des larmes, le cerveau ne marche plus : c'est la devise d'une nation qui, deux ans après l'atrocité, risque de se réveiller avec de nouveaux otages. Et cette fois, qui pleurera pour la raison ?
Conséquences stratégiques pour Israël : un cessez-le-feu à double tranchant
Le 18 octobre 2025, alors que les dernières dépouilles d'otages israéliens rapatriées de Gaza jonchent encore les morgues de Tel-Aviv, Israël respire un air de soulagement teinté d'amertume. L'accord de cessez-le-feu signé le 10 octobre, sous l'égide américaine et qatarie, a libéré les 20 derniers otages vivants contre près de 2 000 prisonniers palestiniens et un engagement à restituer 28 corps.
Mais au-delà des embrassades familiales et des discours triomphaux de Benyamin Netanyahou, quel est le bilan stratégique ? Victoire symbolique ou capitulation déguisée ? Dans un Moyen-Orient où chaque concession est une invitation à l'agression, cet accord expose Israël à des risques existentiels, renforçant ses ennemis tout en fragilisant sa dissuasion militaire. Analyse sans concession des retombées à court, moyen et long terme.
À court terme : un répit précaire, miné par les violations
Immédiatement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël a dû affronter une réalité cruelle : le Hamas, loin d'être éradiqué, reprend du poil de la bête. Les accusations d'Israël contre le Hamas pour violation de l'accord – retards dans la restitution des corps et "difficultés logistiques" invoquées par Gaza – soulignent une asymétrie flagrante. En libérant 1 968 prisonniers, dont des figures notoires de l'Intifada comme Marwan Barghouti ou des assassins de la seconde Intifada, Israël a injecté du sang neuf dans les rangs du Jihad islamique et du Hamas.
Ces libérés, souvent condamnés pour meurtres de masse, ne rentrent pas en retraite : ils réintègrent les réseaux terroristes, boostant le moral des extrémistes à Gaza et en Cisjordanie.
Sur le terrain, le retrait partiel des troupes israéliennes – prévu dans la phase initiale – ouvre une fenêtre pour la reconstruction des tunnels et l'accumulation de roquettes. Plus de 170 000 blessés palestiniens attendent des soins, selon le ministère de la Santé du Hamas, mais cette aide humanitaire massive (accès illimité promis par l'accord) risque de financer indirectement la remilitarisation. Israël gagne un silence des armes temporaire, mais perd l'initiative : Tsahal, figé par la peur d'un "nouveau 7 octobre émotionnel", hésite à riposter fermement aux provocations. Résultat ? Une dissuasion érodée, où chaque tir de roquette mine la crédibilité de la "force absolue" promise par Netanyahou.
À moyen terme : le piège du désarmement fantôme
La phase deux de l'accord, esquissée par le Premier ministre le 10 octobre, prévoit le désarmement du Hamas et la remise de l'administration de Gaza à une entité tierce – potentiellement l'Autorité palestinienne ou un consortium international. Sur le papier, c'est une aubaine : fin du contrôle hamasien sur 2,3 millions d'âmes, et un boulevard pour la normalisation avec l'Arabie saoudite, conditionnée à un "jour d'après" stable.
Donald Trump, artisan du deal avec ses casquettes "Peace Now" distribuées aux ministres israéliens, y voit un legs diplomatique. Mais la réalité stratégique est plus sombre. Le Hamas, qui a déjà "réaffirmé son engagement" tout en traînant des pieds sur les corps, n'a aucune intention de se désarmer sans contrepartie massive. Comme l'explique un expert du Brookings Institution, cet accord "ressemble à ceux rejetés par Israël en 2024 : une pause qui renforce Gaza sans l'affaiblir structurellement".
Les libérations massives – 117 otages déjà rendus depuis le début, mais à quel prix ? – ont libéré des cerveaux terroristes qui pourraient orchestrer des attaques hybrides : drones low-cost, cyber-offensives financées par l'Iran. Et si le Hezbollah, observateur attentif au Liban, profite de ce "modèle" pour exiger des concessions similaires ? Israël risque l'encerclement : un front sud revitalisé, un nord toujours menaçant. Politiquement, Netanyahou sort renforcé auprès des familles d'otages – "Les otages n'avaient plus de valeur stratégique", admettent même certains analystes –, mais affaibli face à l'extrême droite. Les colons de Cisjordanie, furieux contre la libération de "violeurs et assassins", menacent de révolte, fracturant la coalition. L'opposition, menée par Benny Gantz, accuse déjà un "deal de dupes" qui sacrifie la sécurité pour un sursis électoral.
À long terme : une souveraineté hypothéquée ?
L'enjeu fondamental est existentiel : cet accord, fruit d'une "paix des fous" comme la qualifient les faucons israéliens, hypothèque la doctrine de sécurité d'Israël. Fondée sur la supériorité militaire absolue depuis 1967, elle cède du terrain à une "diplomatie des otages" où l'émotion prime sur la force. Le Hamas, qui a "accepté de libérer tous les restants" le 3 octobre, sort légitimé : non plus paria, mais acteur étatique, avec un accès à l'aide internationale qui masque son réarmement. Régionalement, les conséquences cascadent. L'Iran, via ses proxies, teste les limites : des roquettes sporadiques du Yémen signalent déjà une escalade.
Et si la "paix de Trump" – un plan en 20 points incluant un retrait total et une aide de 50 milliards
– attire les investissements du Golfe, elle expose Israël à une dépendance accrue vis-à-vis de Washington. Sans un "jour d'après" clair – qui gérera Gaza post-Hamas ?
–le vide sécuritaire pourrait inviter une nouvelle génération de terroristes.En somme, Israël gagne du temps, mais perd son âme stratégique. Le cessez-le-feu de 2025, comme ceux de 2014 ou 2021, n'est qu'une parenthèse : sans démantèlement total du Hamas, c'est un sursis avant la prochaine tempête.
Netanyahou a sauvé les siens ; reste à savoir s'il a condamné les autres. Pour la survie de l'État juif, la vraie question n'est pas "combien de larmes ?", mais "combien de balles dans la chambre" ?

Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : du déni à tous les étages, sans vergogne, sans sourciller

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

La solitude en fin d’année 2025 : une ombre persistante derrière les lumières des fêtes
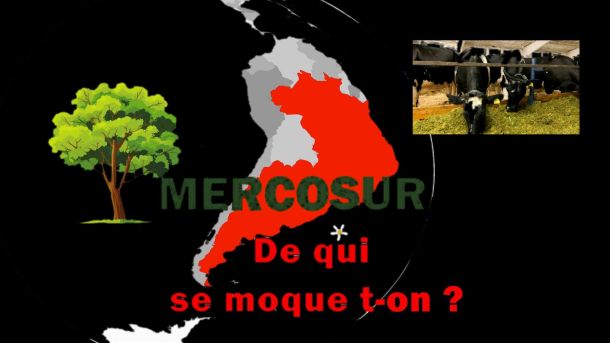
Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »
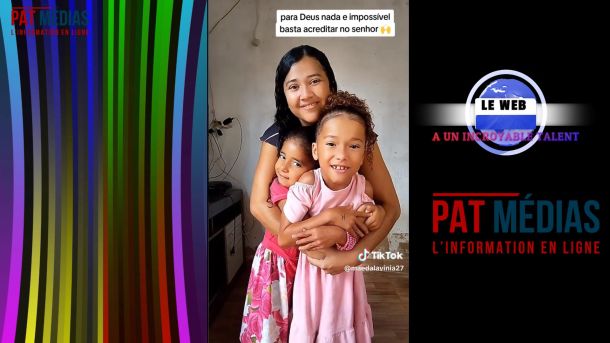
Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour
Catégories d'articles



