
Aujourd'hui, 13 octobre 2025, marque un tournant historique dans le conflit israélo-palestinien avec le début de la libération des 48 otages encore détenus à Gaza par le Hamas, selon les termes du plan de paix impulsé par Donald Trump. Cette opération, attendue dès 7h00 heure locale, doit permettre le retour en Israël de ces captifs – dont 20 présumés vivants et 28 potentiellement décédés –, en échange de la libération par Israël de 250 détenus pour "raisons de sécurité" et de 1 700 Palestiniens arrêtés à Gaza. Le processus se déroule sous haute surveillance, avec un transfert via l'Égypte, et s'inscrit dans la première phase d'un accord de cessez-le-feu global annoncé par le président américain.
Trump au centre de l'acclamation : un leadership américain assumé
Donald Trump, en route vers Charm el-Cheikh pour présider un sommet de la paix, s'impose comme l'architecte incontesté de cette avancée. Il a déclaré que "la guerre à Gaza est terminée", soulignant que les otages seront libérés "à tout moment" dès ce matin. Son intervention diplomatique, incluant un plan en 20 points dévoilé le mois dernier, a été saluée par de nombreux Israéliens comme un coup de maître, contrastant avec les négociations laborieuses des mois précédents. Des voix dans les médias et sur les réseaux sociaux louent son pragmatisme, le voyant comme un médiateur décisif qui a forcé la main du Hamas et d'Israël. Cette acclamation reflète un regain de confiance envers l'Amérique, particulièrement auprès des faucons israéliens qui apprécient son approche musclée.
Netanyahu en retrait : une ombre sur le Premier ministre
Benjamin Netanyahu, bien que central dans les tractations internes, apparaît relégué au second plan. Il a confirmé la libération imminente des 20 otages vivants lors d'une allocution récente, mais son rôle semble éclipsé par l'élan trumpien. Des observateurs notent une tension : le Premier ministre israélien, critiqué pour sa gestion initiale de la crise des otages depuis octobre 2023, doit naviguer entre l'approbation populaire de l'accord et les réserves de son aile droite, qui craint des concessions excessives. Cette position en retrait renforce l'impression d'un leadership israélien affaibli face à l'activisme de Washington.
Les Européens à la traîne : un soutien discret mais essentiel
L'Union européenne, bien qu'ayant salué les principes du plan Trump via une déclaration de son Haut Représentant, peine à s'imposer dans le processus. Des diplomates européens et arabes travaillent en parallèle à affiner la phase de transition – incluant le désarmement du Hamas et le transfert des responsabilités sécuritaires à l'Autorité palestinienne –, mais leur rôle reste en retrait par rapport à l'axe américano-égyptien. Emmanuel Macron a exprimé un "espoir immense" tout en appelant à un respect strict des termes, illustrant une méfiance persistante du Vieux Continent envers la fiabilité des acteurs. Cette "traîne" européenne est perçue comme un manque d'initiative, contrastant avec l'urgence imposée par Trump, et soulève des questions sur l'avenir d'une médiation plus équilibrée.

Le peuple israélien : entre espoir prudent et méfiance palpable
À Tel Aviv, sur la "Place des Otages", l'atmosphère est électrique mais contenue. Après deux ans d'attente fiévreuse, les familles et les citoyens retiennent leur souffle, oscillant entre un espoir prudent de retrouvailles et une méfiance profonde née des échecs passés. Des témoignages décrivent une "fébrilité extrême" : "On est prudents, quelque chose pourrait encore mal tourner", confie une journaliste sur place. Un "scepticisme optimiste" domine, avec des prières et des rassemblements, mais sans euphorie prématurée – on attendra les embrassades des familles pour y croire vraiment. Cette ambivalence reflète les cicatrices du 7 octobre 2023 et les doutes sur la durabilité de l'accord.Ce moment d'arrivée des otages pourrait sceller la fin d'une ère sanglante, mais il porte en lui les germes d'une paix fragile. Les heures à venir, avec le sommet égyptien, diront si l'acclamation pour Trump se muera en gratitude durable, ou si la méfiance l'emportera. Israël, uni dans l'attente, incarne à la fois la résilience et la lassitude d'un peuple marqué par le deuil.

Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : du déni à tous les étages, sans vergogne, sans sourciller

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

La solitude en fin d’année 2025 : une ombre persistante derrière les lumières des fêtes
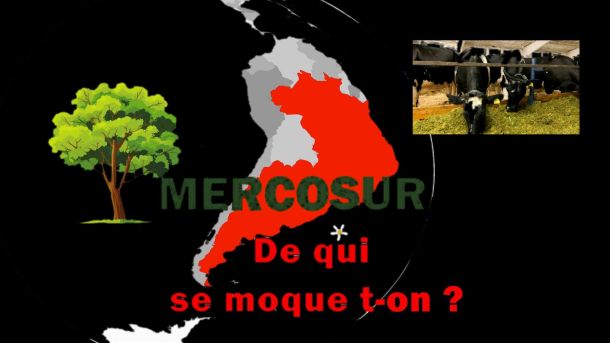
Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »
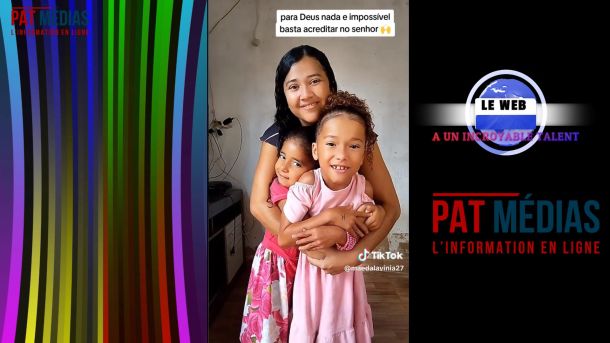
Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour
Catégories d'articles


