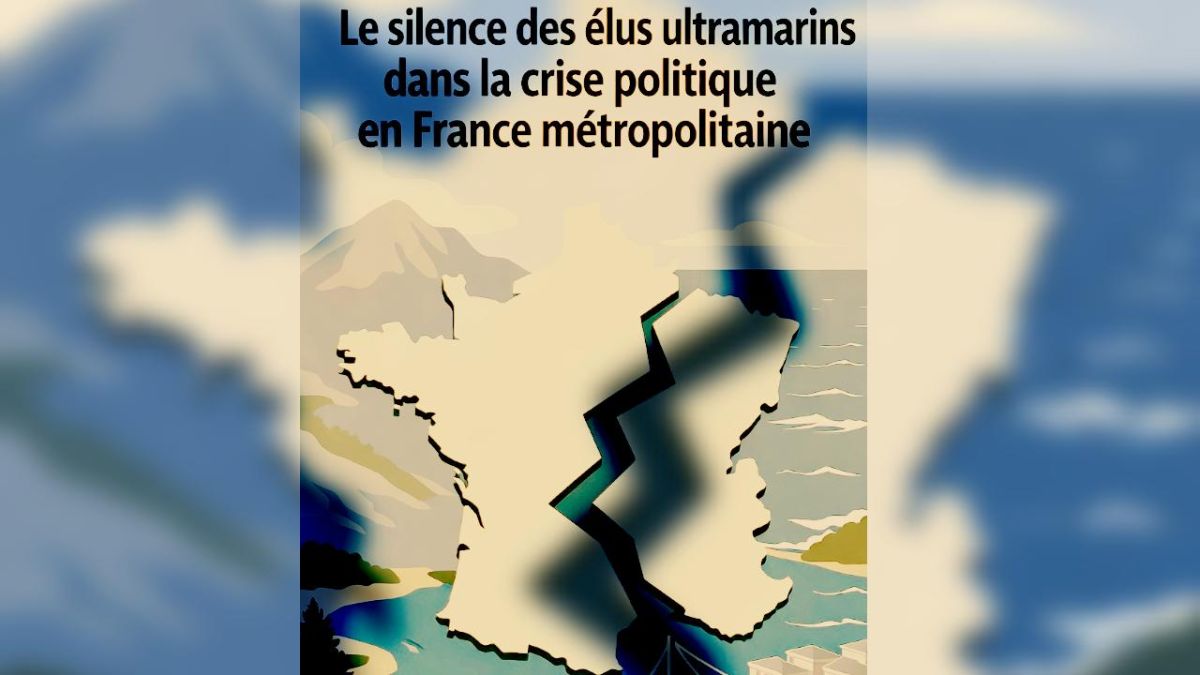
Le silence des élus d'outre-mer face à la tourmente politique hexagonale : une distance stratégique ou un oubli structurel ?
La France traverse, depuis plusieurs semaines, une crise politique d'une ampleur inédite depuis l'adoption de la Ve République en 1958. La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu le 6 octobre, suivie de sa reconduction controversée quatre jours plus tard, a plongé le pays dans un chaos institutionnel.
Sans gouvernement stable, sans majorité claire à l'Assemblée nationale, et avec une dette publique record frôlant les 1400 milliards d'euros, l'Hexagone oscille entre paralysie budgétaire et risque de dégradation de sa note souveraine. Emmanuel Macron, accusé de contournements institutionnels, peine à former une équipe viable, tandis que les partis traditionnels – du PS aux Républicains – se déchirent dans un jeu d'ego parisien. Au milieu de ce tumulte, une voix semble curieusement absente : celle des élus d'outre-mer. Députés, sénateurs et maires des départements et régions d'outre-mer (DROM) ou des collectivités d'outre-mer (COM), qui représentent près de 2,8 millions de Français, affichent un silence relatif.
Comment expliquer cette discrétion face à une crise qui menace l'ensemble de la République ? Entre oubli structurel, priorités locales et stratégie calculée, les raisons sont multiples.
Une crise hexagonale qui résonne faiblement outre-mer.
D'abord, observons les faits. Si les médias métropolitains bruissent de débats enflammés sur la reconduction de Lecornu – qualifiée de "mascarade politique" par la presse internationale – les réactions des élus ultramarins sont sporadiques et mesurées. Lors du dîner à l'Élysée du 30 septembre, organisé par Macron pour évoquer l'avenir institutionnel, les représentants d'outre-mer ont exprimé un scepticisme poli, mais sans tonnerre d'indignation.
La députée de Mayotte, Estelle Youssouffa, a profité de l'occasion pour alerter sur les conséquences locales de la paralysie parisienne, soulignant que "la crise politique à Paris risque d'aggraver les vulnérabilités de Mayotte". De même, Davy Rimane, député de Guyane et président de la Délégation outre-mer à l'Assemblée, dénonce un "oubli des Outre-mer face au chaos politique national" : "Droite, gauche, personne n'a parlé de nos territoires.
La République doit répondre à tout le monde, mais pour l'instant, les Outre-mer, on n'y est pas." La présidente de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer (ACCD'OM), Florence Rolland, maire de La Foa en Nouvelle-Calédonie, appelle quant à elle les dirigeants à "réfléchir avec hauteur" aux impacts sur les territoires ultramarins, exprimant une "angoisse" palpable.Pourtant, ces interventions restent isolées. Au Congrès des élus de Martinique, par exemple, le silence sur la crise hexagonale est qualifié de "stratégique ou de désengagement tacite", alors que l'événement est présenté comme une opportunité historique pour l'autonomie locale. En Nouvelle-Calédonie, les réactions oscillent entre "stupéfaction" et appels au dialogue, sans véritable offensive médiatique. Contrairement aux figures hexagonales comme Jordan Bardella, qui tend la main aux Républicains pour une "union large", les ultramarins ne font pas les gros titres. Ce mutisme apparent n'est pas un désintérêt, mais le reflet d'une fracture plus profonde.
Des priorités locales écrasantes : l'Outre-mer, premier touché par les ondes de choc
L'explication première réside dans l'urgence des enjeux locaux. Les territoires ultramarins, souvent en première ligne des crises nationales, subissent de plein fouet les retombées d'une paralysie parisienne sans pouvoir y remédier.
Crises des Gilets jaunes, Covid, flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation : "Les Outre-mer vivent tout, plus fort, plus tôt et plus vite", comme le résume un courrier des lecteurs publié récemment.
À La Réunion, Florence Rolland alerte sur une "succession des crises nationales" qui renforce le sentiment d'exclusion. En Guyane ou à Mayotte, les élus se concentrent sur des dossiers vitaux : insécurité, accès à l'eau potable, cherté de la vie. La crise politique hexagonale, perçue comme un "syndrome de la porte tambour" – allers-retours incessants à Matignon sans impact concret – passe au second plan face à ces réalités tangibles.Ce focus local s'explique aussi par une défiance historique envers l'Hexagone. Les DROM-COM se sentent souvent relégués au rang de "victimes collatérales" des jeux parisiens, comme l'écrit France Antilles.
Le Congrès des élus de Guadeloupe, en juin 2025, a adopté à l'unanimité des résolutions pour un "changement de régime", réclamant plus d'autonomie. Pourquoi s'époumoner dans un débat qui les ignore ? Comme le note Davy Rimane, "la nation est en crise parce qu'on a un président qui n'écoute pas". Ce silence est donc une forme de protestation passive : en se recentrant sur leurs territoires, les élus ultramarins rappellent que la République n'est pas que parisienne.
Une stratégie de l'ombre : attendre et négocier
Mais ce retrait n'est pas que défensif ; il est aussi tactique. Les élus d'outre-mer, rompus aux négociations avec l'exécutif, misent sur le dialogue en coulisses plutôt que sur l'affrontement public. Le dîner élyséen du 30 septembre en est l'exemple : une occasion pour "évoquer l'avenir institutionnel" sans les feux des projecteurs.
En Nouvelle-Calédonie, où les tensions indépendantistes couvent, les élus calédoniens appellent à "renouer le dialogue" après la démission de Lecornu, évitant d'alimenter une crise qui pourrait déstabiliser les accords de Matignon.
En Martinique, le "consensus creux" du Congrès des élus cache une prudence : critiquer ouvertement risquerait de fermer des portes pour des financements vitaux, bloqués par l'absence de budget national.Cette discrétion s'inscrit dans une culture politique ultramarine, marquée par le pragmatisme face à un centre distant. Comme le souligne Le Monde, les élus sont "sceptiques" avant de rencontrer Macron, mais ils préfèrent influencer en privé que hurler dans le vide. Dans un contexte où la presse européenne qualifie la France de "fin de siècle" ou de "mauvaise comédie", les ultramarins évitent de se brûler les ailes dans un incendie qu'ils n'ont pas allumé.
Vers une République à recomposer ?
Le silence des élus d'outre-mer n'est donc pas une indifférence, mais un miroir tendu à l'Hexagone : une République fracturée, où les territoires périphériques paient les pots cassés d'une centralisation obsolète. Si la crise actuelle perdure – et Lecornu n'a que "quelques heures" pour former son gouvernement ce 12 octobre –, elle pourrait catalyser des revendications plus fortes pour une décentralisation accrue. Déjà, des voix comme celle d'Estelle Youssouffa appellent à ne pas "oublier les conséquences pour l'Outre-mer". Pour sortir de cette impasse, Paris devra écouter ces murmures ultramarins, sous peine de voir le silence se muer en clameur.
En attendant, la crise hexagonale rappelle une évidence : la France n'est pas un hexagone, mais un archipel de voix diverses. Ignorer les unes, c'est fragiliser l'ensemble.

Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : du déni à tous les étages, sans vergogne, sans sourciller

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

La solitude en fin d’année 2025 : une ombre persistante derrière les lumières des fêtes
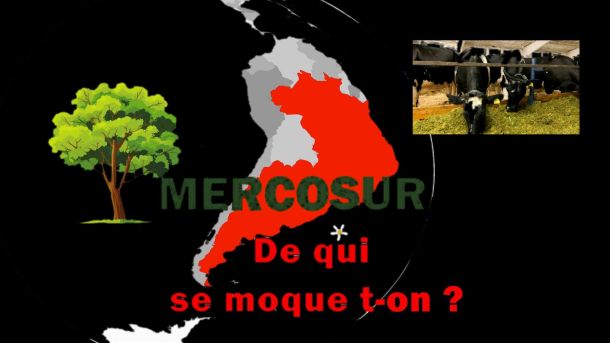
Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »
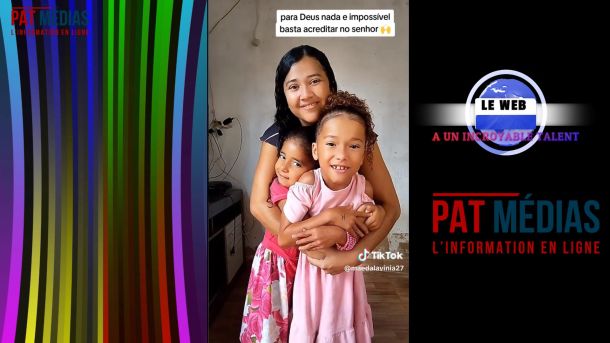
Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour
Catégories d'articles


